«Urushi»: à l’écoute de soi et des autres
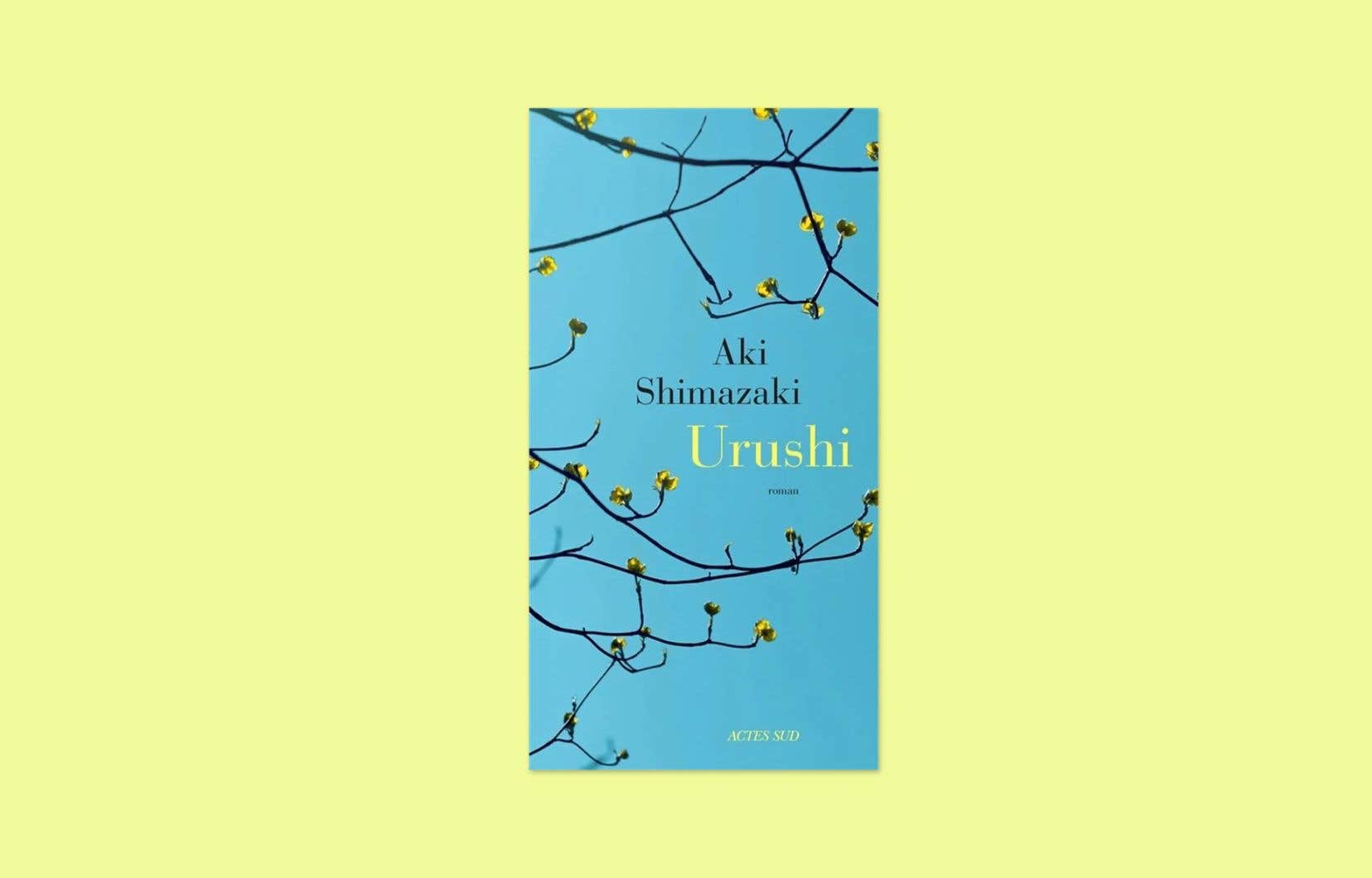
« Il écrit sur sa serviette en papier le kanji “hito 人” — “être humain”. Puis me dit : “Comme on l’apprend à l’école, ce caractère représente deux personnes debout appuyées l’une sur l’autre. C’est le monde des humains. On n’est pas seul et on doit savoir comment coexister avec les gens autour de soi.” »
Dans ce tout nouveau roman, l’autrice montréalaise d’adoption Aki Shimazaki offre une douce incursion dans son pays natal, au pied du mont Daisen, dans une famille japonaise recomposée. Acceptation des autres, amour et estime de soi règnent dans cette courte et tendre histoire qu’on dévore sans même s’en rendre compte.
À l’aube de ses seize ans, Suzuko trouve un moineau blessé dans le jardin. Il ne pourra plus jamais voler, mais elle espère pouvoir le guérir. Il pourrait même apprendre des mots, lui dit-on, si Suzuko fait preuve d’assez de patience. L’adolescente se prête sans hésiter au jeu en murmurant, tous les jours, à l’oreille de ce moineau fragile dont les sonorités de la traduction japonaise, « suzume », évoquent celles de son propre prénom.
Elle appelle l’animal Urushi, d’après une laque naturelle servant un art japonais ancestral, le kintsugi, qui consiste à restaurer des céramiques brisées. Su-zu-ko, Tô-ru, U-ru-shi, répète-t-elle méthodiquement au moineau chaque matin. Suzuko et Tôru, celui qu’elle aime en secret, unis par l’urushi.
Peu après sa naissance, Suzuko a été adoptée par sa tante Anzu, déjà mère d’un garçon âgé d’une dizaine d’années, Tôru. Les deux cousins ont été élevés comme frère et soeur. Malgré leur lien de sang, la jeune fille nourrit un amour débordant pour Tôru depuis sa plus tendre enfance : doux, fort, intelligent, attentionné, il rassemble toutes les qualités. Bien que les sentiments de Suzuko ne semblent pas réciproques, il lui paraît essentiel de déclarer son amour à son frère adoptif. Trouvera-t-elle un moment opportun et une oreille réceptive ?
Vacillant entre joies et déceptions, courage et timidité, l’adolescente écume ses rêves de jeunesse en quelques mois. « Je regrette de ne pas pouvoir réparer son aile de la même manière qu’un bol cassé », déplore-t-elle en songeant au petit animal blessé qui guérit dans sa chambre. C’est que les vies ne peuvent se maîtriser comme les objets. Les liens humains ne sauraient être forcés.
La situation initiale est claire et sans équivoque, les phrases sont franches et limpides. Quelques tournures poétiques nous proposent un temps d’arrêt. On rencontre dans « Urushi » un style d’écriture rappelant d’autres fictions japonaises, comme La papeterie Tsubaki d’Ito Ogawa. Le texte foisonne de métaphores et symboles, provoquant réflexions et méditations qui dépassent largement les quelque cent trente pages du roman, et qui nous habitent encore une fois le livre refermé.
Aki Shimazaki offre, dans cet ultime tome de sa pentalogie Une clochette sans battant, un court récit qui se tient par lui-même — nul besoin d’aller lire « Suzuran », « Sémi », « No-no-yuri » ou « Niré » pour saisir la portée d’Urushi et sa grande douceur, bien que son ton apaisant donne envie de se plonger dans toute l’oeuvre de l’autrice montréalaise.